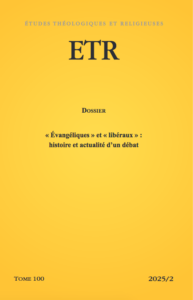Une justice vers le shalom. Les traces d’une eschatologie dans la philosophie politique de Nicholas Wolterstorff
Tome 100 - 2025/2 | DAVID Gonzalo
Cette étude s’attache à identifier les traces d’une eschatologie dans la philosophie politique de Nicholas Wolterstorff, plus particulièrement dans sa théorie de la justice. Dans un premier temps, la recherche présente cet auteur et ses interactions avec d’autres philosophes du monde anglo-américain, principalement en ce qui concerne la place de la religion dans l’espace public des démocraties libérales. Ce contexte est fondamental pour comprendre la pertinence de Wolterstorff dans la philosophie morale et politique de langue anglaise au […]
L’éthique de Ricœur face aux circuits de la corruption. L’Église comme « communauté éthique » face à la corruption dans le contexte togolais
Tome 100 - 2025/1 | YAWO NAKE Joël Setsoafia
Ce travail s’articule autour de la pensée de Ricœur, devenue une boussole pour une éthique pluraliste et une politique institutionnelle capables de résister à la corruption. D’abord suspendu, le jugement moral cède la place à une construction éthique et politique. L’objectif est de bâtir une éthique et une ecclésiologie qui répondent aux défis de la corruption. Ce phénomène dévoile la complexité du rapport humain au bien et au mal. Déconstruire et reconstruire ce rapport, en interrogeant ses strates […]
La politique de la vertu de John Milbank : un post-libéralisme poétique et social de la société/Église
Tome 100 - 2025/1 | BIBRAC Jacques
Par la politique de la vertu, John Milbank propose un renouveau politique autour d’un idéal démocratique de politique sociale d’inspiration catholique. Notre auteur forme son projet politique à partir d’un discours essentiellement ecclésial, car l’ecclésiologie tient lieu chez lui de théorie sociale. La thèse analyse successivement l’ontologie poétique de Milbank, sa théologie politique, et sa « politique du don de la vertu ».
Mots-clés : vertu, ontologie, poétique, post-libéralisme, don, nihilisme, politique, Église, théologie, philosophie, raison
Histoire d’une liberté dans la France moderne. Protestants, politique et monarchie (vers 1598-vers 1629)
Tome 99 - 2024/3 | ARACIL Adrien
Cette thèse interroge l’histoire politique des réformés français au début du xviie siècle au prisme de la notion de liberté : liberté comme défense des acquis juridiques conférés par le régime de l’édit de Nantes, mais aussi et surtout comme capacité d’action, d’appropriation de modes d’action et de reconfiguration constante du cadre au sein duquel celle-ci se déploie. Loin de considérer les huguenots comme les victimes passives d’une « France toute catholique », elle les pense donc comme des acteurs politiques, au […]
Penser le politique pour instituer la liberté. Les débuts de la royauté israélite à l’épreuve de la liberté
Tome 99 - 2024/2 – Les Écritures pour terre natale. Mélanges offerts à Dany Nocquet | WOODY James
La royauté israélite commence par un débat au sujet de la liberté (1 S 8). Une étude historique et une analyse littéraire révèlent que l’ensemble 1 S 8–1 R 12, qui narre les trois premiers règnes (Saül, David, Salomon), a été composé à plusieurs époques historiques. À l’époque de Josias, un texte est rédigé pour soutenir son programme politique. C’est après l’exil à Babylone que la liberté devient une finalité et un critère d’appréciation de la société israélite. Ces éléments sont mis à profit […]
Intégralisme religieux et société libérale. Le cas des juifs orthodoxes en France, des années 1980 à nos jours
Tome 98 - 2023/4 | STRACK Frédéric
Cette thèse envisage la tension entre une conception englobante de la religion portée par les juifs orthodoxes et une conception privatisée et plurielle en vigueur dans la société française, une société laïque et sécularisée, des années 1980 à nos jours. Cette tension est explorée depuis ces deux points de vue. D’une part, la thèse interroge la façon dont les juifs orthodoxes s’organisent pour ménager l’espace jugé nécessaire à leur pratique religieuse. Pour ce faire, elle explore leurs besoins, […]
Dimensions narrative et rhétorique de l’ironie en Gn 37–38.42–44 et Mc 1,1–8,30
Tome 98 - 2023/3 | WAUTERS Audrey
Dans un récit, l’ironie est un procédé basé sur une supériorité du lecteur sur les personnages quant au savoir. Il n’en va pas autrement des récits bibliques, où se rencontrent maintes intrigues jouant sur un décalage entre le savoir détenu respectivement par le lecteur et par un ou des personnages, et cela, au bénéfice du premier. Mais comment l’ironie intervient-elle dans le dispositif narratif de ces récits, et que vient-elle y faire ? Voilà les questions principales que cette […]
Émergence et herméneutique du monothéisme à partir de la notion de reconnaissance de l’autre. Un dialogue avec Jan Assmann
Tome 98 - 2023/3 | VERISSIMO SACILOTTO Patricia
La question du monothéisme est toujours actuelle, vu son lien avec le phénomène de la violence. Selon l’une des thèses de Jan Assmann – la distinction mosaïque –, le monothéisme a instauré une rupture avec les autres religions via sa « conception emphatique de la vérité » et sa prétention à distinguer le vrai du faux. Ce tournant sémantique a introduit dans l’histoire un nouveau rapport au monde et à l’individu dont les répercussions se font encore sentir. L’assise de cette thèse est […]
La clôture comme ouverture. Analyse mémorielle du rôle de 2 Timothée dans le corpus paulinien
Tome 98 - 2023/2 | BULUNDWE K. Luc
Rédigée comme un discours d’adieu, la deuxième épître à Timothée (2 Tm) s’attribue un rôle de clôture dans la biographie de l’apôtre Paul. Comment cette prétention – déguisée ou non – se traduit-elle du point de vue narratif ? Ou, pour le dire autrement, quel rôle 2 Tm endosse-t-elle au sein du corpus paulinien ? Cette question conduit l’argumentaire de la présente thèse de doctorat. Au prisme des approches sociales de la mémoire, cette étude heuristique démontre que le genre littéraire et le […]
Du conflit au dialogue : l’athéisme scientifique en RDA (1963-1990)
Tome 98 - 2023/2 | GUIGO-PATZELT Eva
La discipline universitaire athéisme scientifique a été présente dans la recherche et l’enseignement supérieur est-allemands pendant près de trois décennies. Entre 1963 et 1968, une chaire lui a été dédiée à l’université d’Iéna, suivie de deux décennies de travaux moins exposés aux regards mais non moindres. Les représentants de cette discipline, des philosophes marxistes et membres du parti au pouvoir, étaient les principaux experts du régime sur les phénomènes religieux et espéraient bien exercer une influence sur la […]